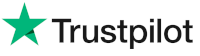- Qu'est-ce qu'une preuve illicite et une preuve déloyale ?
- Quelles sont les preuves irrecevables ?
- Depuis le revirement de jurisprudence par deux arrêts rendus le 22 décembre 2023 n°20-20.648 et n°21.11.330 , est-il possible au nom du droit à la preuve de recueillir de façon déloyale un élément de preuve ?
- De façon concrète, qu'est-ce que ça change en terme de loyauté de la preuve ?
La cour de cassation a récemment effectué un revirement de jurisprudence majeur concernant le régime de la preuve. Quelles sont les règlementations concernant l'administration des preuves illicites et déloyales ?
Qu'est-ce qu'une preuve illicite et une preuve déloyale ?
En matière de droit de la preuve, il existe une différence entre preuve illicite et preuve déloyale.
Une preuve illicite est une preuve obtenue en violation d'une règle de droit ou de la vie privée de la partie adverse. A titre d'exemple, sont jugés comme étant illicites les comptes-rendus de filature d'un détective privé engagé par l'employeur pour suivre le salarié à son insu.
Une preuve déloyale est une preuve qui a été obtenue à l'aide de procédé déloyal, de stratagème ou de façon clandestine, allant à l'encontre des principes de loyauté. A titre d'exemple, il peut s'agir d’un enregistrement vidéo clandestin.
Quelles sont les preuves irrecevables ?
De façon générale, la Cour de cassation fait une différence concernant l'administration et le droit de la preuve.
En effet, concernant la preuve illicite, elle fait preuve d'une certaine flexibilité puisqu'elle a coutume d'affirmer qu'une preuve illicite ne doit pas systématiquement être déclarée irrecevable mais qu'il faut procéder à une mise en balance, à savoir :
- La preuve illicite est indispensable au droit à la preuve ;
- L’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi (1).
Dès lors, une preuve illicite peut être acceptée, à la condition que le juge procède à une analyse concernant sa finalité.
Concernant la preuve déloyale, il est de jurisprudence constante qu'elle est toujours considérée comme étant irrecevable puisqu'elle a été obtenue via un procédé déloyal.
Depuis le revirement de jurisprudence par deux arrêts rendus le 22 décembre 2023 n°20-20.648 et n°21.11.330 , est-il possible au nom du droit à la preuve de recueillir de façon déloyale un élément de preuve ?
La Cour de cassation, en assemblée plénière, a effectué un revirement de jurisprudence majeur concernant le droit à la preuve.
Dans la première affaire, il était question d'un responsable commercial qui contestait son licenciement pour faute grave, arguant notamment de l'irrecevabilité des preuves apportées par l'employeur : un enregistrement clandestin de son entretien préalable prouvant qu'il avait refusé de remettre un rapport sur son activité commerciale (3).
Les juges d'appel refusent l'utilisation des enregistrements clandestins. L'employeur forme alors un pourvoi en cassation au motif que l'enregistrement est "indispensable au droit à la preuve et à la protection des intérêts de l’employeur".
L’affaire est renvoyée devant l’Assemblée plénière. Contre toute attente, la Cour de cassation fait évoluer sa position en matière d'administration de la preuve et opère un revirement de jurisprudence.
En effet, elle affirme désormais que, conformément au droit à la preuve, il est possible de justifier la production de preuves portant atteinte à d'autres droits et libertés fondamentales, à condition que cette production soit :
- Indispensable à son exercice ;
- Et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Le même jour, la Cour de cassation fait application de cette nouvelle jurisprudence au cours d'une seconde affaire. En l'espèce, le remplaçant d'un salarié avait découvert, sur le compte Facebook du salarié remplacé qui était resté accessible sur son ordinateur professionnel, une conversation avec une autre salariée de l'entreprise dans laquelle le salarié absent sous-entendait, et ce de façon insultante, que la promotion dont avait bénéficié un collègue était liée à son orientation sexuelle et à celle de son supérieur hiérarchique. Ayant été informé des échanges, l'employeur avait licencié le salarié pour faute grave (4).
Dans cette affaire, l'Assemblée plénière refuse à l'employeur le droit d'utiliser cette preuve déloyale qui viole le droit à la vie privée du salarié puisqu'un « motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ». Ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
De façon concrète, qu'est-ce que ça change en terme de loyauté de la preuve ?
La cour de cassation a ainsi créé un véritable droit à la preuve concernant les preuves obtenues via un procédé déloyal.
Désormais, les juridictions ne seront plus contraintes de déclarer leur irrecevabilité automatiquement mais devront procéder à une analyse pour contrôler leur proportionnalité.
Ainsi pour déclarer recevable une preuve, les juridictions devront analyser les éléments suivants :
- La preuve est justifiée par un motif légitime ;
- La preuve est indispensable au droit de la preuve ;
- L'atteinte portée au droit doit être proportionné au but recherché. Il s'agit ici de manière courante du droit à la vie privée.
Sources :
1 - Cass. soc. 30 septembre 2020 no 19-12.058
2- Cass. ass. plén. 7 janvier 2011, no09-14.316 et 09-14.667
3- Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n°20-20.648
4- Cass. ass. plén. 22 décembre 2023 n°21.11.330
Photo : Freepik